La gauche et les migrations,
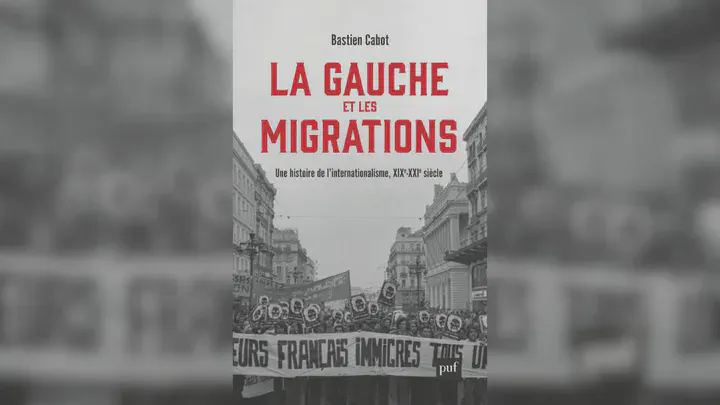
La gauche et les migrations, une histoire de l’internationalisme
La question migratoire n’a jamais été simple à traiter pour le mouvement syndical. Tiraillé entre l’exercice d’une solidarité sans failles et sans frontières entre l’ensemble des travailleurs et travailleuses soumis·es à l’exploitation capitaliste, et la lutte difficile contre les tentations xénophobes attisées par les mouvements nationalistes sur les salariats locaux qui ont toujours habilement joué de la peur d’une concurrence par une main d’oeuvre étrangère, déracinées donc plus malléable par le patronat. C’est l’honneur du syndicalisme, de l’internationalisme, que de n’avoir jamais renoncé, hier comme aujourd’hui, malgré les sirènes démagogiques, à organiser le prolétariat au delà des différences de nationalité, de croyance ou même de genre.
Bastien Cabot, agrégé et docteur en histoire, chercheur à Sciences po, est spécialiste d’histoire sociale, il vient de publier notamment un ouvrage passionnant sur La Gauche et les migrations, ainsi que plusieurs articles sur l’histoire du socialisme, du travail dans la dernière livraison des Cahiers Jean Jaures.
La contradiction de la gauche face aux migrations
Enjeux-UA : Dans votre récent ouvrage, La Gauche et les migrations, Une histoire de l’internationalisme, XIXè et XXè siècles, vous abordez, dans une démarche historique, une certaine contradiction qu’a dû et que doit toujours affronter la Gauche au niveau mondial, qu’il s’agisse des courants socialistes (au sens large) ou du mouvement syndical à visée de transformation sociale, voire révolutionnaire : comment à la fois assurer la solidarité internationale entre le monde du travail soumis au capitalisme et par ailleurs éviter que ce dernier ne joue de la concurrence entre travailleurs nationaux et étranger·es pour revenir sur les conquêtes sociales, notamment la lente construction de l’État social. Pourriez-vous approfondir cette question?
Bastien Cabot : À partir du dernier tiers du XIXe siècle, sous la pression du mouvement ouvrier et des cercles réformateurs, les États industrialisés mettent en place les fondements de la législation sociale contemporaine : reconnaissance du syndicalisme, régulation du travail des femmes et des enfants, limitation de la durée du travail, protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, conciliation et arbitrage dans les conflits du travail, avec éventuellement une incidence sur la détermination des salaires, etc.
Le problème c’est que, dans la grande majorité des cas, les travailleurs étrangers échappent de facto au domaine d’application de ces lois. Si l’on prend l’exemple de la Loi française du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, rien n’interdit en principe aux étrangers d’en être membres, mais en même temps la loi plus ancienne du 3 décembre 1849 peut conduire à l’expulsion du territoire en cas d’activité politique suspecte… Pour les employeurs, l’embauche de travailleurs immigrés signifie donc un allègement considérable des charges sociales qui sont désormais imposées par cette nouvelle législation - et cet allègement est d’autant plus opportun que, dans les secteurs lourds de la seconde industrialisation (mines, chimie, bâtiment), les emplois les plus éprouvants sont de plus en plus désertés par la main-d’œuvre nationale.
Mais pour les travailleurs nationaux les moins qualifiés qui sont en concurrence avec la main-d’œuvre étrangère, cette situation est réellement perçue comme une concurrence déloyale.
Les trois options du mouvement ouvrier international
lll Ainsi, il se crée autour des années 1890-1900 une situation tout à fait paradoxale, dans la mesure où ce sont précisément les conquêtes du mouvement ouvrier qui sont en même temps des facteurs d’accroissement de la concurrence sur le marché du travail, et donc des facteurs de frein à la solidarité avec les travailleurs immigrés. Comment dépasser cette contradiction ? C’est la question à laquelle s’attelle le mouvement ouvrier international de la « Belle époque ».
Globalement, il existe trois options. La première, que l’on voit se mettre en place un peu partout dans les années 1890-1900, c’est le soutien ouvrier et syndical à la fermeture des frontières, car cette fermeture est conçue comme permettant de préserver les acquis sociaux, en les soustrayant à la possibilité de la concurrence : on voit cette logique à l’œuvre aux États-Unis dès les années 1880, en Australie vers 1900, en Grande-Bretagne en 1905 avec « l’Aliens Act », etc.
La seconde, davantage localisée, et qui peut tout à fait être complémentaire de la première, consiste à organiser la main-d’œuvre étrangère dans les syndicats nationaux et à lutter par divers moyens pour obtenir l’égalité juridique. Dans le Pas-de-Calais comme à Longwy ou à Paris, à la fin du siècle, les conseils juridiques des syndicats sont ainsi d’importants vecteurs d’aide à la naturalisation des travailleurs étrangers.
La troisième, qui relève véritablement d’une logique internationaliste, consiste à lutter pour obtenir l’harmonisation globale des conditions de travail et de la législation sociale, précisément pour éviter la possibilité même d’une concurrence à ce niveau.
C’est par exemple ce à quoi œuvrent les réformateurs sociaux Luigi Luzzatti et Arthur Fontaine en 1904, lorsqu’ils font signer à leurs pays respectifs, la France et l’Italie, une convention qui permet le transfert des cotisations sociales (épargne, assurance chômage, accidents) de part et d’autre de la frontière.

L’échec d’un compromis prometteur après la Seconde Guerre Mondiale
Enjeux-UA : Aux lendemains de la Deuxième Guerre Mondiale, le mouvement syndical, au moins en Europe Occidentale et en Amérique du Nord a tenté d’imposer un compromis prometteur par une intervention internationale des syndicats sur les migrations : pourquoi cela a-t-il finalement échoué?
Bastien Cabot : L’idée d’une mise en relation des syndicats des pays d’émigration avec ceux des pays d’immigration, visant à contrôler le nombre ou la qualification des travailleurs migrants, s’appuie sur l’expérience ancienne du « closed-shop », où ce sont les travailleurs d’une entreprise qui décident, à parts égales avec l’employeur, des conditions du recrutement. Ainsi, l’idée de ce que j’appelle un « closed-shop international » voit le jour dès les années 1860-1870, entre les travailleurs britanniques et ceux du continent, ou entre les travailleurs d’Amérique et ceux d’Europe.
Les verriers de Pennsylvanie, par exemple, sont si bien organisés qu’ils parviennent en 1883-1884 à mettre en place des syndicats-frères dans les principaux pays d’émigration d’Europe (Angleterre et Belgique), et les unir au sein d’une « Universal Federation of Window Glass Workers ». Ce principe sera repris et amplifié par la Seconde Internationale dans les années 1900, qui s’efforcera d’encourager la mise en relation internationale des confédérations syndicales, de créer des bureaux destinés à informer sur la situation des pays d’immigration, de collecter des données statistiques, etc.
L’idée renaît au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque les organisations syndicales de quinze pays se retrouvent à Berne en 1919, et signent une Charte internationale du travail qui prévoit, entre autres choses, le contrôle du recrutement des émigrants par les organisations ouvrières des pays d’émigration et d’immigration (notamment, pour ces derniers, en fonction des besoins d’une industrie ou d’une région). Mais le contexte international de l’entre-deux-guerres ne joue guère en la faveur de cette Charte.
En France par exemple, les syndicats, largement affaiblis après 1921-1922, sont dépassés sur leur droite par les industriels, qui mettent en place de leur côté la Société générale d’immigration (SGI) en 1924, une société privée à laquelle l’État délègue le recrutement des travailleurs immigrés. Dans le même temps, le Bureau international du travail, sous la houlette d’Albert Thomas, s’évertue à faire ratifier des traités bilatéraux inspirés de celui de 1904 entre pays d’émigration (tels que la Pologne ou la Tchécoslovaquie) et pays d’immigration (tels que la France), afin de ne pas abandonner totalement la main-d’œuvre immigrée aux abus de la concurrence.
En 1945, la situation change largement par rapport à l’entre-deux-guerres, et les syndicats sont en position de force. En France par exemple, la CGT qui revendique plus de 5 millions d’adhérents parvient à obtenir la dissolution de la SGI en novembre 1945 et la création de l’Office national de l’immigration (ONI), un organisme d’État placé sous la tutelle d’un ministère du Travail alors occupé par le communiste Ambroise Croizat et du ministère de la Santé publique, et qui est censé avoir le monopole sur le recrutement des travailleurs immigrés. La consultation des organisations syndicales joue un rôle majeur dans cette nouvelle organisation, et celles-ci parviennent à imposer le principe d’accords migratoires établis avec les syndicats des pays d’émigration, comme c’est par exemple le cas entre la CGT et la CGIL italienne en 1947.
Toutefois, l’année 1947 constitue en même temps le chant du cygne de l’ONI. Les ministres communistes, principaux soutiens de l’ONI, sont exclus du gouvernement en mai, et, à la fin de l’année, on constate que l’Office n’a assuré que le recrutement que de 64 000 étrangers sur les 200 000 prévus, ce qui déçoit fortement le patronat, et encourage largement le recours à l’immigration clandestine. De ce fait, le monopole migratoire de l’ONI cesse concrètement de s’exercer au début de l’année 1948.
Mondialisation libérale et solidarité internationale : est-ce compatible ?
Enjeux-UA : Même si dans votre introduction, vous prenez soin de préciser que les solutions pour faire face aux problèmes d’aujourd’hui ne sauraient puiser dans le temps passé, en tant qu’historien, pensez-vous compatible la mondialisation libérale et la solidarité internationale des travailleurs et des travailleuses ? Comme pendant les grandes crises économiques de la fin du 19è siècle et des années trente, l’heure n’est-elle pas plutôt aux replis nationalistes autour d’identités ethniques, culturelles et/ou religieuses, comme semblent le démontrer les progrès de l’extrême droite un peu partout?
Bastien Cabot : Je répondrai par plusieurs points à cette question.
Tout d’abord, même si je dis en effet qu’il n’y a pas de solution toute prête à tirer du passé car chaque époque est différente, je souligne néanmoins l’intérêt de conserver ce qui a fait la force du mouvement ouvrier, à savoir sa capacité à proposer une lecture dialectique, matérialiste et pragmatique de la situation. Il y a tout de même quelque chose de frappant dans le fait que, jusqu’aux années 1970, le mouvement ouvrier international n’avait presque aucune doctrine en matière migratoire et a pourtant constamment innové en cherchant à s’adapter à des situations migratoires massives ou dramatiques, alors qu’aujourd’hui, dans une Europe où les migrations sont très sévèrement contrôlées, la gauche est précisément empêtrée dans de purs problèmes d’idéologie. La première chose à faire, avant de se demander ce qui est productif électoralement, devrait donc probablement consister à produire une analyse objective de la situation migratoire.
Or, lorsque l’on observe les tendances des dernières décennies, on constate une relation inversement proportionnelle entre la réalité migratoire et l’inflation considérable du discours à son endroit, de la place que cette problématique occupe dans le débat public.
L’extrême-droite globale profite donc d’une inversion généralisée de la façon de donner du sens au monde, dans laquelle les représentations priment sur les faits. Une fois que ce principe a été posé, le reste de son travail n’est plus que technique : détenir les médias, et les inonder avec l’anxiété culturelle du remplacement démographique ou culturel. Dès lors qu’il n’y a plus qu’un débat par rapport auquel le reste de la classe politique doit se positionner sous peine de disparaître, alors la victoire est déjà remportée.
Enfin, il est tout à fait évident qu’une solidarité internationale des travailleurs et travailleuses est possible, même dans notre monde, mais il est tout aussi évident qu’elle aura une consistance nécessairement différente qu’autrefois. Au XIXe siècle, les conditions technologiques de communication, de transferts financiers, de collecte des données, etc. étaient beaucoup plus contraignantes qu’aujourd’hui, et pourtant il y a eu une volonté de soutenir les mouvements syndicaux et socialistes dans les pays voisins, voire à l’autre bout du monde, car l’objectif était la victoire globale du prolétariat, l’amélioration globale des conditions de travail et de vie, la victoire du socialisme international. Aujourd’hui, les conditions d’exploitation des inégalités économiques internationales n’ont pas cessée : le travail infantile ou le travail forcé existent toujours, le dumping environnemental est largement pratiqué outre-Europe pour s’affranchir des normes, etc.. Alors pourquoi la solidarité internationale n’est-elle pas ce qui nous occupe journellement ? Précisément, à mon sens, parce que c’est cet horizon international (ou global) du socialisme qui est en défaut, parce que l’on a peu ou prou renoncé - et sans doute avec de bonnes raisons - au rêve d’une totalisation idéologique du monde. Mais l’internationalisme peut se réinventer : on en a un exemple récent avec la plateforme « Les Peuples Veulent ». La question fondamentale n’est peut-être pas de savoir par où faire commencer la solidarité, mais plutôt de savoir à quel type d’horizon collectif on aspire.
Propos recueillis par Matthieu Leiritz