Entretien avec Jean-Baptiste Fressoz
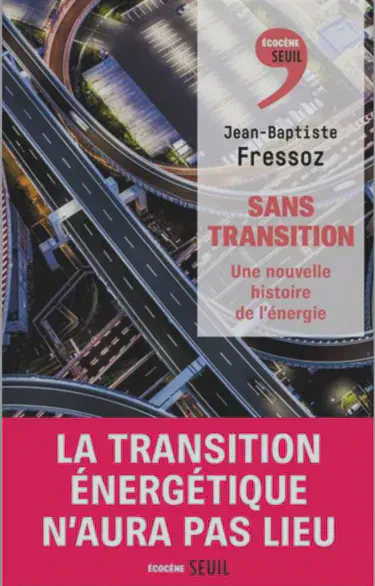
Entretien avec Jean-Baptiste Fressoz
Jean-Baptiste Fressoz est historien des sciences, des techniques et de l’environnement. Chercheur au CNRS, enseignant à l’EHESS et à l’École des ponts et chaussées, il est l’auteur de plusieurs livres, dont L’Événement Anthropocène (avec Christophe Bonneuil, Seuil 2013). Son dernier ouvrage, « Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie » (Seuil 2024) a reçu le prix du livre de l’écologie politique.
Pourquoi ce titre « Sans transition » ? Quels sont selon vous les obstacles à la transition énergétique ?
L’expression de « transition énergétique » est un slogan. Ce que nous faisons avec les renouvelables et dans une moindre mesure avec les voitures électriques, c’est diminuer l’intensité carbone de l’économie (le nombre de grammes de CO2 qu’il faut émettre pour produire un bien ou un service). C’est bien mais c’est climatiquement insuffisant. Et ce n’est pas nouveau non plus. Par exemple dans l’entre-deux-guerres, le remplacement des machines à vapeur par des moteurs électriques a divisé par 10 l’intensité carbone de la force mécanique dans l’industrie. Ce qui se passe actuellement s’inscrit dans une histoire longue du progrès technologique. Depuis les années 1980, l’intensité carbone de l’économie mondiale a été divisée par presque 2, ce qui n’a pas empêché les émissions globales de doubler.
En outre, l’idée qu’on passe d’une énergie à une autre est une simplification problématique. Les énergies et les matières sont profondément intriquées. C’est ce que j’ai étudié dans « Sans transition ». Par exemple l’industrialisation n’est pas une transition énergétique du bois au charbon. Pour une raison toute simple : le charbon nécessite énormément de bois pour être extrait. A tel point que l’Angleterre au XXè siècle consomme plus de bois sous forme d’étais de mines qu’elle ne brûlait de bûches au XVIIIè siècle. En outre, la consommation de bois énergie a beaucoup cru au XXè siècle dans le monde riche comme dans le monde pauvre. De même au XXè siècle toute l’infrastructure pétrolière et les automobiles dépendent de l’acier et du ciment et donc du charbon. Le pétrole a stimulé la consommation et la production de charbon. De même de nos jours, les voitures électriques émettent certes moins de CO2 que les voitures à essence, mais leur fabrication requiert toujours beaucoup de fossiles. Le seul secteur où le terme de transition énergétique pourrait être acceptable est celui de la production électrique, mais il ne représente que 40% des émissions. Pour une bonne moitié des émissions - aviation, transport maritime, sidérurgie, cimenterie, plastique, viande etc. Il faudrait surtout penser la décroissance. L’expression « transition énergétique » donne l’impression qu’une solution technologique est possible dans les échéances temporelles pertinentes pour nos objectifs climatiques.
Reflux de l’écologie politique et tensions géopolitiques
Comment percevez-vous les reculs actuels sur les questions écologiques (coupes dans les budgets, attaques contre les agences environnementales, contre les scientifiques) ?
Dans un contexte de tensions géopolitiques et même de guerre, la question environnementale passe au second plan. Le problème est aussi que les objectifs de neutralité carbone imposent des choix difficiles. Tout le monde le sent et cela nécessite une répartition équitable des efforts et donc des politiques de redistribution, ce que les gouvernements actuels refusent de faire. Le reflux de l’écologie politique depuis 2022 ressemble à ce qui s’était passé aux États-Unis à la fin des années 1970 : le mouvement environnemental a été stoppé net par la thématique de la « crise énergétique » et par un puissant mouvement conservateur. Cela étant l’attaque anti-science de Trump est d’une autre nature, plus proche du maccarthysme que des stratégies d’influence des think tanks néolibéraux auxquelles on avait été habitués. En un sens cela clarifie les enjeux.